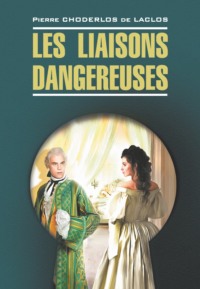
Опасные связи / Les liaisons dangereuses. Книга для чтения на французском языке
Par où, dites-moi, ai-je mérité cette rigueur désolante ? Je ne crains pas de vous prendre pour juge : qu’ai-je donc fait que céder à un sentiment involontaire, inspiré par la beauté et justifié par la vertu ; toujours contenu par le respect, et dont l’innocent aveu fut l’effet de la confiance et non de l’espoir : la trahirez-vous, cette confiance que vous-même avez semblé me permettre, et à laquelle je me suis livré sans réserve ? Non, je ne puis le croire ; ce serait vous supposer un tort, et mon cœur se révolte à la seule idée de vous en trouver un : je désavoue mes reproches ; j’ai pu les écrire, mais non pas les penser. Ah ! laissez-moi vous croire parfaite ; c’est le seul plaisir qui me reste. Prouvez-moi que vous l’êtes en m’accordant vos soins généreux. Quel malheureux avez-vous secouru, qui en eût autant de besoin que moi ? ne m’abandonnez pas dans le délire où vous m’avez plongé : prêtez-moi votre raison, puisque vous avez ravi la mienne ; après m’avoir corrigé, éclairez-moi pour finir votre ouvrage.
Je ne veux pas vous tromper, vous ne parviendrez point à vaincre mon amour ; mais vous m’apprendrez à le régler ; en guidant mes démarches, en dictant mes discours, vous me sauverez au moins du malheur affreux de vous déplaire. Dissipez surtout cette crainte désespérante ; dites-moi que vous me pardonnez, que vous me plaignez ; assurez-moi de votre indulgence. Vous n’aurez jamais toute celle que je vous désirerais ; mais je réclame celle dont j’ai besoin : me la refuserez-vous ?
Adieu, Madame ; recevez avec bonté l’hommage de mes sentiments ; il ne nuit point à celui de mon respect.
De …, ce 20 août 17**.
Lettre XXV. Le Vicomte de Valmont à la Marquise de Merteuil
Voici le bulletin d’hier .
À onze heures j’entrai chez Mme de Rosemonde ; et, sous ses auspices, je fus introduit chez la feinte malade, qui était encore couchée. Elle avait les yeux très battus ; j’espère qu’elle avait aussi mal dormi que moi. Je saisis un moment, où Mme de Rosemonde s’était éloignée, pour remettre ma lettre : on refusa de la prendre ; mais je la laissai sur le lit, et allai bien honnêtement approcher le fauteuil de ma vieille tante, qui voulait être auprès de sa chère enfant : il fallut bien serrer la lettre pour éviter le scandale. La malade dit, maladroitement, qu’elle croyait avoir un peu de fièvre. Mme de Rosemonde m’engagea à lui tâter le pouls, en vantant beaucoup mes connaissances en médecine. Ma belle eut donc le double chagrin d’être obligée de me livrer son bras, et de sentir que son petit mensonge allait être découvert. En effet, je pris sa main que je serrai dans une des miennes, pendant que de l’autre je parcourais son bras frais et potelé ; la malicieuse personne ne répondit à rien, ce qui me fit dire, en me retirant : « Il n’y a pas même la plus petite émotion. » Je me doutai que ses regards devaient être sévères, et, pour la punir, je ne les cherchai pas ; un moment après, elle dit qu’elle voulait se lever, et nous la laissâmes seule. Elle parut au dîner, qui fut triste ; elle annonça qu’elle n’irait pas se promener, ce qui était me dire que je n’aurais pas l’occasion de lui parler. Je sentis bien qu’il fallait placer là un soupir et un regard douloureux ; sans doute elle s’y attendait, car ce fut le seul moment de la journée où je parvins à rencontrer ses yeux. Toute sage qu’elle est, elle a ses petites ruses comme une autre. Je trouvai le moment de lui demander si elle avait eu la bonté de m’instruire de mon sort, et je fus un peu étonné de l’entendre me répondre : Oui, Monsieur, je vous ai écrit. J’étais fort empressé d’avoir cette lettre ; mais soit ruse encore, ou maladresse, ou timidité, elle ne me la remit que le soir, au moment de se retirer chez elle. Je vous l’envoie ainsi que le brouillon de la mienne ; lisez et jugez ; voyez avec quelle insigne fausseté elle affirme qu’elle n’a point d’amour quand je suis sûr du contraire ; et puis elle se plaindra si je la trompe après, lorsqu’elle ne craint pas de me tromper avant ! Ma belle amie, l’homme le plus adroit ne peut encore que se tenir au courant de la femme la plus vraie. Il faudra pourtant feindre de croire à tout ce radotage, et se fatiguer de désespoir, parce qu’il plaît à Madame de jouer la rigueur ! Le moyen de ne se pas venger de ces noirceurs-là !… Ah ! patience… mais adieu. J’ai encore beaucoup à écrire.
À propos, vous me renverrez la lettre de l’inhumaine ; il se pourrait faire par la suite qu’elle voulût qu’on mît du prix à ces misères-là, et il faut être en règle.
Je ne vous parle pas de la petite Volanges ; nous en causerons au premier jour.
Du château, ce 22 août 17**.
Lettre XXVI. La Présidente de Tourvel au Vicomte de Valmont
Sûrement, Monsieur, vous n’auriez eu aucune lettre de moi, si ma sotte conduite d’hier au soir ne me forçait d’entrer aujourd’hui en explication avec vous. Oui, j’ai pleuré, je l’avoue ; peut-être aussi les deux mots, que vous me citez avec tant de soin, me sont-ils échappés ; larmes et paroles, vous avez tout remarqué ; il faut donc vous expliquer tout.
Accoutumée à n’inspirer que des sentiments honnêtes, à n’entendre que des discours que je puis écouter sans rougir, à jouir par conséquent d’une sécurité que j’ose dire que je mérite, je ne sais ni dissimuler ni combattre les impressions que j’éprouve. L’étonnement et l’embarras où m’a jetée votre procédé ; je ne sais quelle crainte, inspirée par une situation qui n’eût jamais dû être faite pour moi ; peut-être l’idée révoltante de me voir confondue avec des femmes que vous méprisez, et traitée aussi légèrement qu’elles ; toutes ces causes réunies ont provoqué mes larmes, et on pu me faire dire, avec raison, je crois, que j’étais malheureuse. Cette expression, que vous trouvez si forte, serait sûrement beaucoup trop faible encore, si mes pleurs et mes discours avaient eu un autre motif ; si, au lieu de désapprouver des sentiments qui doivent m’offenser, j’avais pu craindre de les partager.
Non, Monsieur, je n’ai pas cette crainte ; si je l’avais, je fuirais à cent lieues de vous ; j’irais pleurer dans un désert le malheur de vous avoir connu. Peut-être même, malgré la certitude où je suis de ne vous point aimer, de ne vous aimer jamais, peut-être aurais-je mieux fait de suivre les conseils de mes amis ; de ne pas vous laisser approcher de moi.
J’ai cru, et c’est là mon seul tort, j’ai cru que vous respecteriez une femme honnête, qui ne demandait pas mieux que de vous trouver tel et de vous rendre justice ; qui déjà vous défendait, tandis que vous l’outragiez par vos vœux criminels. Vous ne me connaissez pas ; non, Monsieur, vous ne me connaissez pas. Sans cela, vous n’auriez pas cru pouvoir vous faire un droit de vos torts : parce que vous m’avez tenu des discours que je ne devais pas entendre, vous ne vous seriez pas cru autorisé à m’écrire une lettre que je ne devais pas lire : et vous me demandez de guider vos démarches, de dicter vos discours ! Hé bien, Monsieur, le silence et l’oubli, voilà les conseils qu’il me convient de vous donner, comme à vous de suivre : alors, vous aurez, en effet, des droits à mon indulgence : il ne tiendrait qu’à vous d’en obtenir même à ma reconnaissance… Mais non, je ne ferai point une demande à celui qui ne m’a point respectée ; je ne donnerai point une marque de confiance à celui qui a abusé de ma sécurité. Vous me forcez à vous craindre, peut-être à vous haïr : je ne le voulais pas ; je ne voulais voir en vous que le neveu de ma plus respectable amie ; j’opposais la voix de l’amitié à la voix publique qui vous accusait. Vous avez tout détruit ; et, je le prévois, vous ne voudrez rien réparer.
Je m’en tiens, Monsieur, à vous déclarer que vos sentiments m’offensent, que leur aveu m’outrage, et surtout que, loin d’en venir un jour à les partager, vous me forceriez à ne vous revoir jamais, si vous ne vous imposiez sur cet objet un silence qu’il me semble avoir droit d’attendre, et même d’exiger de vous. Je joins à cette lettre celle que vous m’avez écrite, et j’espère que vous voudrez bien de même me remettre celle-ci ; je serais vraiment peinée qu’il restât aucune trace d’un événement qui n’eût jamais dû exister. J’ai l’honneur d’être, etc.
De …, ce 21 août 17**.
Lettre XXVII. Cécile Volanges à la Marquise de Merteuil
Mon Dieu, que vous êtes bonne, Madame ! comme vous avez bien senti qu’il me serait plus facile de vous écrire que de vous parler ! Aussi, c’est que ce que j’ai à vous dire est bien difficile ; mais vous êtes mon amie, n’est-il pas vrai ? Oh ! oui, ma bien bonne amie ! Je vais tâcher de ne pas avoir peur ; et puis, j’ai tant besoin de vous, de vos conseils ! J’ai bien du chagrin ; il me semble que tout le monde devine ce que je pense ; et surtout quand il est là, je rougis dès qu’on me regarde. Hier, quand vous m’avez vue pleurer, c’est que je voulais vous parler, et puis, je ne sais quoi m’en empêchait ; et quand vous m’avez demandé ce que j’avais, mes larmes sont venues malgré moi. Je n’aurais pas pu dire une parole. Sans vous, Maman allait s’en apercevoir, et qu’est-ce que je serais devenue ? Voilà pourtant comme je passe ma vie , surtout depuis quatre jours !
C’est ce jour-là, Madame, oui, je vais vous le dire, c’est ce jour-là que M. le Chevalier Danceny m’a écrit : oh ! je vous assure que quand j’ai trouvé sa lettre, je ne savais pas du tout ce que c’était. Mais, pour ne pas mentir, je ne peux pas dire que je n’aie eu bien du plaisir en la lisant. Voyez-vous, j’aimerais mieux avoir du chagrin toute ma vie, que s’il ne me l’eût pas écrite ! Mais je savais bien que je ne devais pas le lui dire, et je peux bien vous assurer même que je lui ai dit que j’en étais fâchée : mais il dit que c’était plus fort que lui, et je le crois bien ; car j’avais résolu de ne lui pas répondre, et pourtant je n’ai pas pu m’en empêcher. Oh ! je ne lui ai écrit qu’une fois, et même c’était, en partie, pour lui dire de ne plus m’écrire : mais malgré cela il m’écrit toujours ; et comme je ne lui réponds pas, je vois bien qu’il est triste, et ça m’afflige encore davantage : si bien que je ne sais plus que faire, ni que devenir, et que je suis bien à plaindre.
Dites-moi, je vous en prie, Madame, est-ce que ce serait bien mal de lui répondre de temps en temps ? seulement jusqu’à ce qu’il ait pu prendre sur lui de ne plus m’écrire lui-même, et de rester comme nous étions avant : car, pour moi, si cela continue, je ne sais pas ce que je deviendrai. Tenez, en lisant sa dernière lettre, j’ai pleuré, que ça ne finissait pas ; et je suis sûre que si je ne lui réponds pas encore, cela nous fera bien de la peine.
Je vais vous envoyer sa lettre aussi, ou bien une copie, et vous jugerez ; vous verrez bien que ce n’est rien de mal qu’il demande. Cependant si vous trouvez que ça ne se doit pas, je vous promets de m’en empêcher ; mais je crois que vous penserez comme moi, que ce n’est pas là du mal.
Pendant que j’y suis, Madame, permettez-moi de vous faire encore une question : on m’a bien dit que c’était mal d’aimer quelqu’un ; mais pourquoi cela ? Ce qui me fait vous le demander, c’est que M. le Chevalier Danceny prétend que ça n’est pas mal du tout, et que presque tout le monde aime ; si cela était, je ne vois pas pourquoi je serais la seule à m’en empêcher ; ou bien est-ce que ce n’est un mal que pour les demoiselles ? car j’ai entendu Maman elle-même dire que Mme D… aimait M. M… et elle n’en parlait pas comme d’une chose qui serait si mal ; et pourtant je suis sûre qu’elle se fâcherait contre moi, si elle se doutait seulement de mon amitié pour M. Danceny. Elle me traite toujours comme un enfant, Maman ; et elle ne me dit rien du tout. Je croyais, quand elle m’a fait sortir du couvent, que c’était pour me marier ; mais à présent il me semble que non : ce n’est pas que je m’en soucie, je vous assure ; mais vous, qui êtes si amie avec elle, vous savez peut-être ce qui en est, et si vous le savez, j’espère que vous me le direz.
Voilà une bien longue lettre, Madame , mais puisque vous m’avez permis de vous écrire, j’en ai profité pour vous dire tout, et je compte sur votre amitié.
J’ai l’honneur d’être, etc.
Paris, ce 23 août 17**.
Lettre XXVIII. Du Chevalier Danceny à Cécile Volanges
Eh ! quoi, Mademoiselle, vous refusez toujours de me répondre ! rien ne peut vous fléchir ; et chaque jour emporte avec lui l’espoir qu’il avait amené ! Quelle est donc cette amitié que vous consentez qui subsiste entre nous, si elle n’est pas même assez puissante pour vous rendre sensible à ma peine ? si elle vous laisse froide et tranquille, tandis que j’éprouve tous les tourments d’un feu que je ne puis éteindre ? si loin de vous inspirer de la confiance, elle ne suffit pas même pour faire naître votre pitié ? Quoi ! votre ami souffre et vous ne faites rien pour le secourir ? Il ne vous demande qu’un mot, et vous le lui refusez ? et vous voulez qu’il se contente d’un sentiment si faible, dont vous craignez encore de lui réitérer les assurances ?
Vous ne voudriez pas être ingrate, disiez-vous hier ! ah ! croyez-moi, Mademoiselle ; vouloir payer de l’amour avec de l’amitié, ce n’est pas craindre l’ingratitude, c’est redouter seulement d’en avoir l’air. Cependant je n’ose plus vous entretenir d’un sentiment qui ne peut que vous être à charge, s’il ne vous intéresse pas ; il faut au moins le renfermer en moi-même, en attendant que j’apprenne à le vaincre. Je sens combien ce travail sera pénible ; je ne me dissimule pas que j’aurai besoin de toutes mes forces ; je tenterai tous les moyens : il en est un qui coûtera le plus à mon cœur, ce sera celui de me répéter souvent que le vôtre est insensible. J’essaierai même de vous voir moins, et déjà je m’occupe d’en trouver un prétexte plausible.
Quoi ! je perdrais la douce habitude de vous voir chaque jour ! Ah ! du moins je ne cesserai jamais de la regretter. Un malheur éternel sera le prix de l’amour le plus tendre ; et vous l’aurez voulu, et ce sera votre ouvrage ! Jamais, je le sens, je ne retrouverai le bonheur que je perds aujourd’hui ; vous seule étiez faite pour mon cœur ; avec quel plaisir je ferais le serment de ne vivre que pour vous ! Mais vous ne voulez pas le recevoir ; votre silence m’apprend assez que votre cœur ne vous dit rien pour moi ; il est à la fois la preuve la plus sûre de votre indifférence, et la manière la plus cruelle de me l’annoncer. Adieu, Mademoiselle.
Je n’ose plus me flatter d’une réponse ; l’amour l’eût écrite avec empressement, l’amitié avec plaisir, la pitié même avec complaisance : mais la pitié, l’amitié et l’amour sont également étrangers à votre cœur.
Paris, ce 23 août 17**.
Lettre XXIX. Cécile Volanges à Sophie Carnay
Je te le disais bien, Sophie, qu’il y avait des cas où on pouvait écrire ; et je t’assure que je me reproche bien d’avoir suivi ton avis, qui nous a tant fait de peine, au Chevalier Danceny et à moi. La preuve que j’avais raison, c’est que Mme de Merteuil, qui est une femme qui sûrement le sait bien, a fini par penser comme moi. Je lui ai tout avoué. Elle m’a bien dit d’abord comme toi : mais quand je lui ai eu tout expliqué, elle est convenue que c’était bien différent ; elle exige seulement que je lui fasse voir toutes mes lettres et toutes celles du Chevalier Danceny, afin d’être sûre que je ne dirai que ce qu’il faudra ; ainsi, à présent, me voilà tranquille. Mon Dieu, que je l’aime Mme de Merteuil ! elle est si bonne ! et c’est une femme bien respectable. Ainsi il n’y a rien à dire.
Comme je m’en vais écrire à M. Danceny, et comme il va être content ! il le sera encore plus qu’il ne croit : car jusqu’ici je ne lui parlais que de mon amitié, et lui il voulait toujours que je dise mon amour. Je crois que c’était bien la même chose ; mais enfin je n’osais pas, et il tenait à cela. Je l’ai dit à Mme de Merteuil ; elle m’a dit que j’avais eu raison, et qu’il ne fallait convenir d’avoir de l’amour, que quand on ne pouvait plus s’en empêcher : or je suis bien sûre que je ne pourrai pas m’en empêcher plus longtemps ; après tout c’est la même chose, et cela lui plaira davantage.
Mme de Merteuil m’a dit aussi qu’elle me prêterait des livres, qui parlaient de tout cela, et qui m’apprendraient bien à me conduire, et aussi à mieux écrire que je ne fais : car, vois-tu, elle me dit tous mes défauts, ce qui est une preuve qu’elle m’aime bien ; elle m’a recommandé seulement de ne rien dire à Maman de ces livres-là, parce que ça aurait l’air de trouver qu’elle a trop négligé mon éducation, et ça pourrait la fâcher. Oh ! je ne lui en dirai rien.
C’est pourtant bien extraordinaire qu’une femme qui ne m’est presque pas parente, prenne plus de soin de moi que ma mère ! c’est bien heureux pour moi de l’avoir connue !
Elle a demandé aussi à Maman de me mener après-demain à l’Opéra, dans sa loge ; elle m’a dit que nous y serions toutes seules, et nous causerons tout le temps, sans craindre qu’on nous entende ; j’aime bien mieux cela que l’Opéra. Nous causerons aussi de mon mariage : car elle m’a dit que c’était bien vrai que j’allais me marier ; mais nous n’avons pas pu en dire davantage. Par exemple, n’est-ce pas encore bien étonnant que Maman ne m’en dise rien du tout ?
Adieu, ma Sophie, je m’en vais écrire à M. le Chevalier Danceny. Oh ! je suis bien contente.
De …, ce 24 août 17**.
Lettre XXX. Cécile Volanges au Chevalier Danceny
Enfin, Monsieur, je consens à vous écrire, à vous assurer de mon amitié, de mon amour, puisque, sans cela, vous seriez malheureux. Vous dites que je n’ai pas bon cœur ; je vous assure bien que vous vous trompez, et j’espère qu’à présent vous n’en doutez plus. Si vous avez eu du chagrin de ce que je ne vous écrivais pas, croyez-vous que ça ne me faisait pas de la peine aussi ? Mais c’est que, pour toute chose au monde, je ne voudrais pas faire quelque chose qui fût mal ; et même je ne serais sûrement pas convenue de mon amour, si j’avais pu m’en empêcher : mais votre tristesse me faisait trop de peine. J’espère qu’à présent vous n’en aurez plus, et que nous allons être bien heureux.
Je compte avoir le plaisir de vous voir ce soir, et que vous viendrez de bonne heure ; ce ne sera jamais aussi tôt que je le désire. Maman soupe chez elle, et je crois qu’elle vous proposera d’y rester : j’espère que vous ne serez pas engagé, comme avant-hier. C’était donc bien agréable, le souper où vous alliez, car vous y avez été de bien bonne heure ? Mais enfin ne parlons pas de ça : à présent que vous savez que je vous aime, j’espère que vous resterez avec moi le plus que vous pourrez ; car je ne suis contente que lorsque je suis avec vous, et je voudrais bien que vous fussiez tout de même.
Je suis bien fâchée que vous êtes encore triste à présent, mais ce n’est pas ma faute. Je demanderai à jouer de la harpe aussitôt que vous serez arrivé, afin que vous ayez ma lettre tout de suite. Je ne peux pas mieux faire.
Adieu, Monsieur. Je vous aime bien, de tout mon cœur : plus je vous le dis, plus je suis contente ; j’espère que vous le serez aussi.
De …, ce 24 août 17**.
Lettre XXXI. Le Chevalier Danceny à Cécile Volanges
Oui, sans doute, nous serons heureux. Mon bonheur est bien sûr, puisque je suis aimé de vous ; le vôtre ne finira jamais, s’il doit durer autant que l’amour que vous m’avez inspiré. Quoi ! vous m’aimez, vous ne craignez plus de m’assurer de votre amour ! Plus vous me le dites, et plus vous êtes contente ! Après avoir lu ce charmant je vous aime, écrit de votre main, j’ai entendu votre belle bouche m’en répéter l’aveu. J’ai vu se fixer sur moi ces yeux charmants, qu’embellissait encore l’expression de la tendresse. J’ai reçu vos serments de vivre toujours pour moi. Ah ! recevez le mien de consacrer ma vie entière à votre bonheur ; recevez-le, et soyez sûre que je ne le trahirai pas.
Quelle heureuse journée nous avons passée hier ! Ah ! pourquoi Mme de Merteuil n’a-t-elle pas tous les jours des secrets à dire à votre Maman ? pourquoi faut-il que l’idée de la contrainte qui nous attend vienne se mêler au souvenir délicieux qui m’occupe ? pourquoi ne puis-je sans cesse tenir cette jolie main qui m’a écrit je vous aime ! la couvrir de baisers, et me venger ainsi du refus que vous m’avez fait d’une faveur plus grande ?
Dites-moi, ma Cécile, quand votre Maman a été rentrée ; quand nous avons été forcés, par sa présence, de n’avoir plus l’un pour l’autre que des regards indifférents ; quand vous ne pouviez plus me consoler par l’assurance de votre amour, du refus que vous faisiez de m’en donner des preuves, n’avez-vous donc senti aucun regret ? ne vous êtes-vous pas dit : Un baiser l’eût rendu plus heureux, et c’est moi qui lui ai ravi ce bonheur ? Promettez-moi, mon aimable amie, qu’à la première occasion vous serez moins sévère. A l’aide de cette promesse, je trouverai du courage pour supporter les contrariétés que les circonstances nous préparent ; et les privations cruelles seront au moins adoucies, par la certitude que vous en partagez le regret.
Adieu, ma charmante Cécile : voici l’heure où je dois me rendre chez vous. Il me serait impossible de vous quitter, si ce n’était pour aller vous revoir. Adieu, vous que j’aime tant ! vous, que j’aimerai toujours davantage !
De …, ce 25 août 17**.
Lettre XXXII. Madame de Volanges à la Présidente de Tourvel
Vous voulez donc, Madame, que je croie à la vertu de M. de Valmont ? J’avoue que je ne puis m’y résoudre, et que j’aurais autant de peine à le juger honnête, d’après le fait isolé que vous me racontez, qu’à croire vicieux un homme de bien reconnu, dont j’apprendrais une faute. L’humanité n’est parfaite dans aucun genre, pas plus dans le mal que dans le bien. Le scélérat a ses vertus, comme l’honnête homme a ses faiblesses. Cette vérité me paraît d’autant plus nécessaire à croire, que c’est d’elle que dérive la nécessité de l’indulgence pour les méchants comme pour les bons, et qu’elle préserve ceux-ci de l’orgueil, et sauve les autres du découragement. Vous trouverez sans doute que je pratique bien mal, dans ce moment, cette indulgence que je prêche ; mais je ne vois plus en elle qu’une faiblesse dangereuse, quand elle nous mène à traiter de même le vicieux et l’homme de bien.
Je ne me permettrai point de scruter les motifs de l’action de M. de Valmont ; je veux les croire louables comme elle : mais en a-t-il moins passé sa vie à porter dans les familles le trouble, le déshonneur et le scandale ? Ecoutez, si vous voulez, la voix du malheureux qu’il a secouru, mais qu’elle ne vous empêche pas d’entendre les cris de cent victimes qu’il a immolées. Quand il ne serait, comme vous le dites, qu’un exemple du danger des liaisons, en serait-il moins lui-même une liaison dangereuse ? Vous le supposez susceptible d’un retour heureux ? Allons plus loin ; supposons ce miracle arrivé : ne resterait-il pas contre lui l’opinion publique, et ne suffit-elle pas pour régler votre conduite ? Dieu seul peut absoudre au moment du repentir ; il lit dans les cœurs ; mais les hommes ne peuvent juger les pensées que par les actions ; et nul d’entre eux, après avoir perdu l’estime des autres, n’a droit de se plaindre de la méfiance nécessaire, qui la lui rend si difficile à recouvrer. Songez surtout, ma jeune amie, que quelquefois il suffit, pour la perdre, d’avoir l’air d’y attacher trop peu de prix ; et ne taxez pas cette sévérité d’injustice ; car, outre qu’on est fondé à croire qu’on ne renonce pas à ce bien précieux quand on a droit d’y prétendre, celui-là est en effet plus près de mal faire, qui n’est plus contenu par ce frein puissant. Tel serait cependant l’aspect sous lequel vous montrerait une liaison intime avec M. de Valmont, quelque innocente qu’elle pût être.
Effrayée de la chaleur avec laquelle vous le défendez, je me hâte de prévenir les objections que je prévois. Vous me citerez Madame de Merteuil ; à qui on a pardonné cette liaison ; vous me demanderez pourquoi je le reçois chez moi : vous me direz que, loin d’être rejeté par les gens honnêtes, il est admis, recherché même dans ce qu’on appelle la bonne compagnie. Je peux, je crois, répondre à tout.
D’abord Mme de Merteuil, en effet très estimable, n’a peut-être d’autre défaut que trop de confiance en ses forces ; c’est un guide adroit qui se plaît à conduire un char entre les rochers et les précipices, et que le succès seul justifie : il est juste de la louer, il serait imprudent de la suivre ; elle-même en convient et s’en accuse. A mesure qu’elle a vu davantage, ses principes sont devenus plus sévères ; et je ne crains pas de vous assurer qu’elle-même penserait comme moi.